Charles Pougens: Jocko
 | Jocko au théâtre |
 | Préface |
 | Table |
 | Sir Thomas Browne |
 | Info |
Cette page est de James Eason
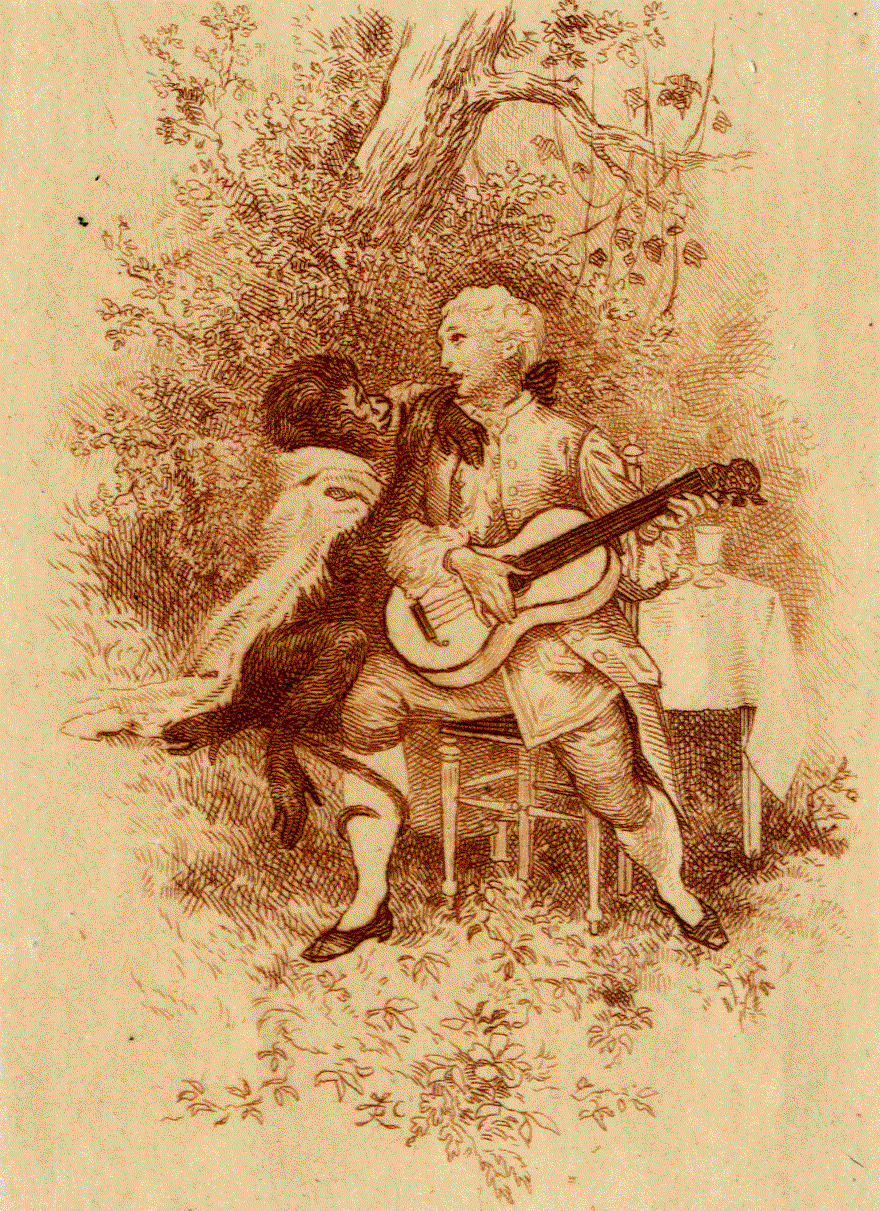
JOCKO
J'habitais depuis plusieurs années l'île de ... ; mais comme je ne veux pas être connu, je m'abstiendrai de dire quelles étaient mes fonctions, et je supprimerai tous détails qui pourraient révéler mon nom à un public en général insouciant ou malin. Toutefois je rapporterai l'anecdote suivante, parce que les souvenirs m'en sont chers, douloureusement chers…, et aussi parce qu'elle renferme un fait singulier, qui fut en partie la cause de l'opulence dont je jouis aujourd'hui.
Nous étions au plus fort de l'été : cinq heures du soir venaient de sonner à la grande horloge de l'église paroissiale ; le soleil dardait encore ses rayons sur la terre. Fatigué des soins que m'imposaient les devoirs de ma place, et naturellement mélancolique, je sortis de chez moi et j'allai me promener seul dans la forêt de ***, peu distante de la maison que j'occupais depuis mon séjour dans l'île. A peine avais-je fait deux cents pas dans une allée obscure, et qui était d'une fraîcheur admirable, que j'entendis un léger bruit vers ma gauche. Un être vivant paraissait à travers le feuillage. Je prêtai l'oreille, mais bientôt je n'entendis plus rien ; je continuai alors ma promenade, et je repris le cours de mes réflexions. Depuis que j'avais laissé mes convives, mes soi-disant amis, tumultueusement groupés autour d'une table chargée de vins exquis, je n'étais plus seul, car j'étais avec moi-même et mes souvenirs.
Une second bruissement semblable au premier se fait encore entendre ; je m'arrête et j'aperçois, à travers plusieurs branches entrelacées, une petite tête de forme presque ronde ; deux charmants yeux taillés en amande dirigeaient vers moi des regards caressants (1) ; un petit nez court sans être camus, deux lèvres bien fraîches, de petites dents blanches comme du lait (2) rendaient cette figure sinon jolie, du moins très piquante. La peau me parut, au premier coup d'oeil, assez semblable à la couleur d'une jeune souris, rehaussée d'une légère teinte argentée.
La figure fit un mouvement et se montra presque à mi-corps. Je m'avançai pour la saisir ; mais en moins d'une seconde elle grimpa, ou, pour mieux dire, elle s'élança vers la cime d'un cocotier. Ses membres étaient souples et déliés ; j'ajouterai que, autant qu'il me fut possible d'en juger, sa taille pouvait être d'environ quatre pieds deux à trois pouces (3).
Blottie avec grâce entre plusieurs branches chargées de feuilles, elle me considéra attentivement. Je lui fis signe de venir à moi, elle imita mon geste et me fit signe de venir à elle ; j'eusse été assez embarrassé de lui obéir, car bien que je fusse encore fort leste, mon agilité était loin d'égaler la sienne.
Naturellement curieux, mes nombreux voyages m'avaient fourni de fréquentes occasions d'observer les diverses familles des singes (4), les orangs (5), les jockos (6), les pongos (7) ; je reconnus sans peine que le jeune individu que j'avais sous les yeux était une femme de cette dernière espèce ; cependant je lui donnai par la suite le nom de Jocko, parce qu'il me paraissait plus joli.
J'avais coutume de porter toujours un peu de pain dans mes poches, et j'aimais à le distribuer aux petits oiseaux que je trouvais sur ma route, durant mes longues et solitaires promenades. Voyant qu'elle m'examinait toujours avec une attention avide, je lui jetai un peu de pain. Elle descendit du cocotier sur lequel elle s'était réfugiée, et se précipitant à terre avec la rapidité d'une flèche, elle prit le petit morceau de pain, le flaira à diverses reprises (8), me regarda, le considéra ensuite d'un air de méfiance (9), et ne le mangea point. Je connaissais ce genre d'hésitation naturelle à l'espèce des jockos et des pongos : pour le faire cesser, je pris un second morceau de pain, j'en mangeai la moitié et je lui jetai le reste. Elle le saisit à la volée avec un adresse surprenante, le mangea ; puis, ramassant le premier morceau qui était resté à terre, elle le flaira une seconde fois et l'avala ensuite avec avidité.
Comme je demeurai quelques moments immobile, elle avança vers moi sa petite main, en l'agitant avec une sorte d'impatience ; elle semblait m'inviter à récidiver mes dons : je lui jetai, en effet, plusieurs autres petits morceaux de pain qu'elle saisissait toujours avec une adresse admirable ; mais sitôt que je faisais un pas en avant, elle s'enfuyait à une longue distance, et ne se laissait jamais approcher. Je fis des mouvements inverses ; je marchai à reculons en lui jetant toujours de temps en temps un peu de pain ; la jolie petite patte restait constamment tendue vers moi ; elle la secouait légèrement en la ramenant vers elle, et faisait entendre par intervalles un petit cri perlé et argentin (10) qu'elle variait sur divers tons, et qui sûrement signifiait quelque chose. Voyant enfin que je ne lui jetais plus rien, elle prit subitement son parti, s'élança comme un trait sur un magnifique cocotier, en détacha plusieurs noix, et les fit tomber à mes pieds. J'en ouvrit une avec un large couteau que j'avais sur moi ; je bus un peu du lait et mangeai un morceau de la chair ; ensuite je m'éloignai pour laisser à ma jolie petite Jocko la liberté de s'accommoder du reste, ce qu'elle ne manqua pas de faire, mais d'un air à me convaincre que cet aliment n'était rien moins que nouveau pour elle, et que ce n'était pas la première fois qu'elle mangeait la chair et buvait le lait d'une noix de coco (11). Le jour commençant à baisser, je m'acheminai vers la ville. La charmante petite créature me suivait en me faisant entendre par intervalles ce cri argentin que je trouvais si joli. Voyant que je ne répondais plus à ses appels, elle s'en retourna d'un air triste et s'éloigna avec lenteur.
Le lendemain, je revins à peu près à la même heure. Ma jolie petite Jocko m'attendait vers l'entrée du bois : couchée au milieu d'une touffe de jeunes arbustes, elle avait écarté les branches et regardait à travers les feuilles. Du plus loin qu'elle m'aperçut, elle courut à ma rencontre avec de grandes démonstrations de joie ; sa marche fut si rapide, qu'elle toucha presque mes habits. Effrayée de cette approche en quelque sorte involontaire, elle s'enfuit et alla se réfugier au haut d'un arbre éloigné de moi de plus de cent pas. Craignant de l'effaroucher davantage, je pris un air indifférent, et je jetai deux ou trois petits morceaux de pain sur la route ; elle descendit doucement les flaira, sans doute afin de reconnaître s'ils étaient de même nature que ceux de la veille, et les mangea avec appétit. J'avais fait une ample provision de biscuits tendres, je lui en jetai la moitié d'un (12) ; elle le saisit à la volée comme elle avait fait la veille, le flaira, parut indécise et ne le mangea point. Je mis dans ma bouche une partie de l'autre moitié, et je lui jetai le reste, qu'elle dévora alors en un clin d'oeil, ainsi que le morceau qu'elle tenait déjà ; ensuite elle manifesta son plaisir par des gambades, de petits sauts (13) ; elle tournait sur elle-même et s'élançait de terre en décrivant de jolis lacs d'amour, avec une grâce et une agilité vraiment surprenantes ; puis elle avançait quelques pas vers moi et me tendait ses deux petites mains, afin que je lui donnasse de nouveaux biscuits.
Chaque après-midi, mêmes scènes : j'arrivais les poches pleines et je m'en retournais à vide. Toutes les fois que je lui donnais des gâteaux d'une espèce nouvelle, mêmes hésitations, mêmes doutes de sa part ; elle n'en mangeait qu'après m'en avoir vu manger le premier.
Attentive à guetter mon arrivée dans la forêt, un jour elle accourut à ma rencontre, déposa devant moi, mais toujours à une assez grande distance, plusieurs belles noix de coco, et plaça à côté une espèce de caillou tranchant. J'admirai son instinct ; j'ouvris deux des plus belles noix, j'en pris une et m'éloignai, afin de lui permettre de s'approcher et de prendre l'autre. Je bus le lait, je mangeai une partie de la chair, elle m'imita : tout en mangeant, elle me regardait d'un air satisfait, et me faisait entendre ce joli cri, qui, la première fois, avait paru si agréable à mon oreille.
Cette scène me suggéra une idée pour le lendemain. Indépendamment de ma provision ordinaire de biscuits, de gâteaux, de tartelettes, je pris avec moi une fiole d'excellent vin de Calcavallo, que j'avais emporté de Lisbonne. J'en versai dans un verre, j'affectai d'en boire une partie ; ensuite je posai le verre à mes pieds et je me retirai à quelques pas. Ma petite Jocko s'approcha doucement, prit le verre avec une grande dextérité, but le vin en se reprenant à diverses fois (14) ; puis, me regardant d'un surpris et satisfait, elle passa en même temps sa langue sur ses petites lèvres, et, lorsqu'elle eut fini de boire, elle posa le verre à la même place où elle l'avait pris ; je m'en emparai, et j'allai le laver dans un creux d'arbre qui contenait un peu d'eau de pluie ; je le remplis ensuite à moitié, je l'approchai de ma bouche, et j'abandonnai le reste à ma petite amie, qui parut le savourer avec encore plus de sensualité que la première fois. Ensuite, toujours fidèle dans ses imitations, elle alla rincer le verre et le replaça au même endroit, espérant que j'allais encore le remplir, ce que je ne fis point, voulant la ménager.
En effet, ce vin, quoique très doux, avait agi sur ses sens. Les yeux de ma petite Jocko paraissaient plus animés ; elle était plus expansive, plus confiante, et se familiarisait au point de s'approcher de moi assez près pour toucher légèrement mes habits du bout de ses doigts. J'aurais pu la saisir sans peine ; mais je m'en gardai bien : je ne voulais ni l'affliger, ni lui rendre ses premières méfiances.
Les jours suivants, mon vin de Calcavallo, mon vin de Xérex, dont je lui versai avec discrétion de légères doses, paraissaient toujours lui faire le même plaisir. Enfin je m'avisai de lui porter d'excellente liqueur des îles, dont j'avais une assez bonne provision. Après lui avoir fait manger un peu plus de mes friandises qu'à l'ordinaire, je posai devant elle un petit verre de crème de créole : elle parut d'abord surprise et inquiète ; mais bientôt le plaisir l'emporta, elle avança ses deux petites pattes en dansant autour de moi ; c'était sa manière de me demander quelque chose. Je plaçai un second verre devant elle, mais à moitié plein, car je craignais de nuire à la santé de ce charmant animal. La petite Jocko le saisit avec avidité ; mais elle ne but la liqueur que peu à peu et à doses modérés ; elle semblait la savourer avec délices. Bientôt il s'ensuivit une demi-ivresse qui se manifesta dans ses regards ; alors ses craintes, ses hésitations disparurent, elle se précipita sur moi, appuya sa petite tête sur mon épaule, la roula en folâtrant sur ma poitrine. Je marchais toujours, elle me suivait en piétinant ; je lui donnais de temps en temps de petits gâteaux, elle les mangeait sans mêmes les regarder : il n'était plus question de méfiance entre nous. Je pris son bras droit, je le passai sous mon bras gauche et nous continuâmes à marcher ainsi près d'un quart de mille (15). Tantôt elle me quittait pour courir après des papillons (16), tantôt elle marchait à mes côtés et conformait ses pas aux miens avec une justesse admirable.
Comme ses bras, sans être entièrement disproportionnés, étaient un peu plus longs que dans l'espèce humaine, je m'avisai de prendre ses deux mains et de les croiser devant elle. Je ne sais quelles furent ses idées, mais elle s'effraya, s'éloigna de moi de quelques pas, et prit un petit air boudeur. Je me rappelai alors ce que j'avais lu dans plusieurs relations de voyages, ce que j'avais observé moi-même à diverses reprises sur la pudeur naturelle aux femelles de cette espèce (17), et ma mémoire me retraçant plusieurs faits de l'histoire ancienne, je frémis d'horreur ; mais, en jetant les yeux sur la petite Jocko, je souris de mon indignation, et je fus tenté de placer au rang des fables, ou de considérer comme des caprices de l'art, certaines représentations grecques et même romaines, que j'avais vues en Italie, spécialement à Portici, et sur plusieurs médailles antiques.
Je la rappelai du geste et de la voix ; je lui présentai un petit gâteau, elle revint le manger sans donner aucun signe de satisfaction, et marcha long-temps sur la même ligne que moi, mais à une assez grande distance.
Il fallait se séparer ; je m'amusai à lui ôter mon chapeau et à lui faire un profond salut. D'abord elle me parut un peu embarrassée, mais elle eut bientôt pris son parti ; elle arracha plusieurs feuilles de bananier, et façonna avec adresse une espèce de coiffe : ce fut l'affaire d'un instant ; puis elle la posa sur sa tête, et me fit à son tour un profond salut de l'air du monde le plus comiquement grave. Ensuite chacun de nous s'en alla de son côté, non sans tourner nos regards l'un vers l'autre à diverses reprises.
Le lendemain, elle m'aborda coiffée d'un capuchon de feuilles entrelacées et plus artistement travaillées que celles de la veille ; elle tenait en sa main une espèce de canne ornée de quelques feuilles légères et assez semblables à un thyrse (18). Je trouvai qu'elle avait dans cette attitude un petit air moitié enfantin, moitié redoutable, qui me fit sourire. Elle m'avait apporté plusieurs belles noix de coco ; nous en mangeâmes la chair, nous en bûmes le lait ; je lui donnai des morceaux de biscuits, un peu de bon vin ; nous étions les meilleurs amis du monde, lorsqu'il survint une scène qui pensa nous brouiller ; je vais la raconter en peu de mots.
Je m'étais muni, sans dessein formel, d'un petit miroir ; je le tirai de ma poche et je lui présentai subitement. Au même instant, la surprise, l'effroi et une affreuse jalousie se peignirent dans ses regards (19) ; elle se jeta avec rage sur cette figure pour la déchirer en pièces. Ne saisissant rien, elle tourna, ou, pour mieux dire, elle s'élança de nouveau, et répéta plus de vingt fois ce pénible manège. Qu'on ose dire maintenant que les animaux ne font pas des abstractions ! ... Sage Locke, répondez (20).
Enfin, hors d'haleine, agitée, tremblante, elle se précipita vers moi, roule avec une sorte de frénésie sa jolie petite tête sur ma poitrine, m'enlace avec ses deux bras en me serrant de toute sa force, comme si elle eût voulu m'entraîner loin de l'objet de ses inquiétudes et de sa terreur. Je remis le fatal miroir dans ma poche, je le caressai, je lui donnai quelques friandises dont je m'étais amplement muni ; je lui fis boire un peu de liqueur, et nous eûmes bientôt fait la paix. Mais elle me regardait avec une expression extraordinaire ; on eût dit qu'elle voulait me parler. Ce soir-là, elle ne pouvait me quitter ; j'avais beau lui faire signe de s'en aller, et même l'écarter de la main, elle s'attachait à mes habits, s'éloignait de quelques pas, et revenait sans cesse vers moi. Arrivé aux derniers arbres de la forêt, elle s'arrête tout à coup, élève son bras droit vers le soleil couchant (21), penche tristement la tête, jette un cri à la fois si douloureux et si tendre, que je ne pus m'empêcher d'être ému. J'avoue que ce geste, qui avait quelque chose de solennel, me surprit et me donna beaucoup à penser. Je me rappelai dans cet instant que quelques naturalistes observateurs avaient donné à entendre, sans d'ailleurs l'articuler une manière précise, qu'ils n'étaient pas éloignés de croire que les individus de cette race avaient à leur manière une idée, du moins vague, d'un Être Suprême. Non, cette faculté intellectuelle qu'on nomme vulgairement l'instinct des bêtes, n'a encore été ni mesurée, ni appréciée. O philosophie ! que de régions inconnues tu as encore à parcourir !
Malheureusement, le lendemain de cette scène, un hasard que je ne puis m'empêcher de nommer fâcheux ne me permit pas de me trouver à notre rendez-vous ordinaire. Je fus retenu chez moi par diverses affaires importantes qui ne me laissèrent pas un moment de loisir. Je ne revis donc ma petite amie que le surlendemain. Hélas ! Je ne la trouvait point au lieu où je la rencontrais ordinairement. Je l'appelai, mais en vain ; mon inquiétude était extrême. J'allai en avant : Jocko ! Jocko ! m'écriai-je, où est-tu ? Je frappai des mains. Enfin je la trouvai étendue à terre, au même endroit où je lui avais montré le fatal miroir ; elle était presque sans mouvement. La chère petite créature ouvrit les yeux et tressaillit en m'apercevant. Je lui fis avaler quelques gouttes d'un cordial que j'avais sur moi. Sa respiration paraissait difficile, embarrassée ; tout son corps était d'une faiblesse extrême. Je lui donnai à manger, elle avait peine à avaler ce que je lui présentais. Lorsqu'elle fut un peu remise, je vis bien, à l'avidité avec laquelle elle saisissait ce que je lui offrais, que le pauvre animal avait été au moins vingt-quatre heures sans prendre aucune nourriture.
Lorsque sa faim fut apaisée et que nous eûmes bu le lait de plusieurs noix de coco, nous reprîmes notre promenade ordinaire : on sait que je l'avais accoutumée à marcher à mes côtés. Tout à coup elle s'arrête, puis elle s'abat à mes pieds, les presse de ses lèvres, et entrelace ses bras autour de mes jambes ; j'eus peine à les en détacher : enfin je parvins à la relever ; son corps tremblait comme la feuille ; je la fis asseoir, je voulus la faire manger, je lui présentai des massepains qu'elle aimait beaucoup, elle me les rendit d'un air triste, et lorsque le jour commença à tomber, elle reprit d'elle-même le chemin qui conduisait à la tête du bois. Durant toute la route, elle me parut pensive et préoccupée ; enfin elle se sépara de moi en me jetant un regard si expressif que je ne pus m'empêcher de la considérer moi-même avec une sorte d'inquiétude.
Je revins le jour suivant à l'heure accoutumée, et, cette fois encore, je ne la trouvai point ; je l'appelai et je m'assis pour l'attendre. Une demi-heure après, je la vis s'élancer vers moi avec sa légèreté ordinaire ; elle était hors d'haleine : je lui présentai un biscuit et un peu de vin dans un verre ; elle refusa le biscuit, se jeta sur le vin, l'avala d'un trait, saisit une de mes mains et voulut m'entraîner avec elle dans l'épaisseur du bois. J'avoue que j'hésitai un peu à la suivre ; je craignais d'y trouver quelques individus de son espèce, et en trop grand nombre pour que je pusse me défendre. Je savais que les mâles, assez dangereux pour les femmes, étaient fort méchants avec les hommes (22). Cependant, après avoir un peu réfléchi, je réprimai ce mouvement de timidité involontaire, que je traitai même intérieurement de pusillanimité, et je la suivis en riant. Elle était agitée et avait un air d'impatience auquel je ne concevais rien. Nous fîmes près d'un tiers de mille à travers les broussailles, et non sans difficulté de ma part.
Je ne pus me défendre d'un sentiment de surprise, lorsque j'aperçus, au milieu d'un groupe d'élégants cocotiers, une jolie hutte couverte de feuillage et presque entièrement achevée (23) ; mais je me rappelai bientôt que l'existence de ces constructions agrestes était constatée par plusieurs voyageurs célèbres et par nos premiers naturalistes. Ma petite Jocko ne se sentait pas d'aise ; elle sautait, elle frappait ses mains l'une contre l'autre et faisait entendre ce joli cri perlé et argentin, qui était chez elle un de ses grands signes de joie ; mais bientôt un nuage de tristesse se répandit sur tous ses traits, lorsqu'elle s'aperçut que je ne pouvais entrer dans sa cabane sans me baisser étrangement. Elle avait fait la porte proportionnée à sa petite taille, et nullement à la mienne ; sa prévoyance n'avait pas été jusque-là. Alors il lui prit une espèce de rage ; elle se précipita sur la branche de traverse qui déterminait la hauteur de cette espèce de baie, renversa tout, puis elle m'entraîna à quelques pas de là, et après m'avoir chargé de quelques rameaux qu'elle y avait rassemblés de provision, elle en prit elle-même autant qu'elle put en embrasser, me fit signer de la suivre ; j'obéis, et le roi prétendu de la nature devint pour cette fois le manœuvre de la femelle d'un pongo.
A l'instant même elle se mit à refaire l'entrée de la hutte ; il ne lui fallut qu'un coup d'oeil pour la proportionner à ma taille élevée. Je l'aidai de la meilleure foi du monde, et l'ouvrage ne tarda pas à être achevé. Dans l'intérieur, près de la porte, je trouvai deux longs sièges de mousse en forme de lits (24), et dans un des angles, une ample provision de noix de coco. Le cher petit animal, épuisé de fatigue, se jeta sur un de ces lits de repos, et parut m'inviter à suivre son exemple, en me montrant du doigt celui qui était en face.
La gentille Jocko me regardait d'un petit air satisfait : elle était toute fière de me voir jouir ainsi de son ouvrage. Quelques moments après, je me levai, j'allai cueillir des feuilles de bananier, je les étendis sur la mousse, afin qu'elle ne s'attachât à mes habits ni aux membres de ma petite architecte ; elle paraissait enchantée de ce que je perfectionnais ainsi son travail, et à vingt reprises différentes, elle sauta avec agilité sur les deux sièges de mousse.
Après s'être livrée sans réserve à ces accès de gaieté, l'appétit lui revint ; elle s'assit sur son lit et étendit vers moi ses deux petites pattes, en les secouant avec sa grâce ordinaire. Je lui donnai du pain, des œufs durs, dont elle n'avait point encore mangé jusqu'alors, de bons biscuits tendres ; elle dévorait : la chère petite créature avait dû passer toute la nuit et une partie du jour à travailler. Nous bûmes du vin de Madère : je lui avais appris, pour m'amuser, à choquer son verre contre le mien (25). Enfin, nous fîmes un repas vraiment délicieux.
Il fallut nous quitter : je ne puis peindre quel fut l'étonnement, la douleur de la pauvre Jocko (26) ; son angoisse était au comble. Elle parut d'abord comme frappée de la foudre, elle resta immobile, se pencha un instant vers moi, ne fit aucun mouvement pour me retenir ; mais lorsque je sortis de la hutte, elle poussa un cri si plaintif que je ne pus m'empêcher de revenir sur mes pas. Je ne négligeai rien pour lui faire entendre que je reviendrais le lendemain : j'ignore si elle me comprit, mais je vis bien qu'elle avait arrangé dans sa petite tête que nous ne devions plus nous quitter. Pour cet effet, elle avait bâti une cabane, fait des provisions de fruits, de noix de coco, enfin un établissement dans toutes les règles, et à sa manière.
Tout ceci m'intéressait sans me surprendre. Je savais que les individus de la race des jockos et des pongos avaient pour habitude de se bâtir des huttes, qu'ils vivaient le plus souvent deux à deux (27), que la femelle avait une sorte de pudeur, que l'usage de se baiser au front ou sur les joues, lorsqu'ils se rencontraient,leur était commun avec les individus de la race humaine (28) ; qu'accoutumés à vivre en société, du moins en famille (29), ils connaissaient l'usage du feu, qu'ils savaient très bien allumer, mais qu'ils ne savaient point entretenir (30).
Le lendemain, j'affectai d'arriver plus tôt que de coutume. J'eus peine à retrouver la cabane. Ma petite Jocko était couchée sur son lit de repos ; elle tressaillit lorsqu'elle m'aperçut et jeta son cri perlé ordinaire. J'avais pris avec moi une scie, un marteau, des clous, une petite cassette fermant avec des crochets, remplie de menus ustensiles ; deux tasses, deux verres à boire, quelques assiettes, une cafetière, un briquet, de l'amadou. Voulant mettre à l'épreuve l'instinct et la perfectibilité de ces animaux, vérifier enfin ce que j'avais lu dans un si grand nombre de voyages et d'écrits sur l'histoire naturelle, faits singuliers qui, je l'avoue, avaient excité en moi plus d'un doute, je donnai tous ces trésors à ma petite amie ; elle était dans le ravissement, la joie brillait dans ses yeux.
Chaque jour je me faisais un plaisir d'apporter de nouveaux meubles dans la jolie cabane de Jocko ; une cruche pour puiser de l'eau, de petites tables, des pliants, une petite commode que je transportait pièce à pièce, ne voulant mettre personne dans ma confiance, et qu'ensuite je montais comme je pus.
Une après-midi ayant dessein d'allumer du feu, je me mis en devoir de lui apprendre à battre le briquet, et je ne pus m'empêcher de rire de sa maladresse : elle frappait sur les doigts et avait peur des étincelles qui jaillissaient de la pierre. Je la lui ôtai, et d'un seul coup je fis prendre l'amadou ; je me servis en même temps d'une allumette soufrée, j'allumai une bougie. Jocko était stupéfaite ; elle regardait ce spectacle, nouveau pour elle, avec une sorte d'admiration mêlée de crainte, qui ajoutait je ne sais quoi de piquant à sa physionomie déjà si expressive.
J'avais préparé, à quelque distance de la hutte, un espace assez grand pour établir au milieu un foyer. Elle ne témoigna aucune surprise, mais ce qu'elle me parut ignorer, comme je viens de le dire, c'était l'art d'alimenter et d'entretenir le brasier, en y jetant du nouveau bois ou en l'attisant avec soin. J'avais apporté des pinces, une pelle ; je lui appris à s'en servir, et je dois convenir ici qu'elle avait une facilité admirable à concevoir et à imiter ce que je faisais. Il est vrai qu'il me fallait répéter plus d'une fois mes leçons.
Je l'envoyai puiser de l'eau (31), j'en remplis une cafetière et une petite casserole, puis je m'amusais à lui apprendre à faire du café, ensuite du thé dans un théière de terre de Delft, qui faisait partie du ménage de Jocko. Elle trouvait le thé, le café excellents, surtout quand j'y mettais beaucoup de sucre. Elle le remuait d'une manière si plaisante avec de petite cuillers de bois (32) dont je m'étais muni, que je ne pouvais m'empêcher de sourire. Enfin, elle était parvenue à faire cuire des œufs frais ou à les faire durcir à volonté, à couper des mouillettes avec un petit couteau à manche de buis que je lui avais donné ; mais j'eus bien de la peine à lui enseigner la dose convenable de café et de thé pour que l'un ou l'autre ne fut ni trop fort ni fort faible.
J'étais cependant venu à bout de lui apprendre à dresser une table devant sa cabane, à la couvrir de larges feuilles de bananier (33), à poser pour elle et pour moi deux sièges vis-à-vis l'un de l'autre, à garnir son petit guéridon de feuilles fraîches et de fleurs, à bien placer son assiette en face de la mienne, à arranger avec une sorte de symétrie, sur de petits plateaux de bois vernissé, les fruits ou les confitures sèches et les petits gâteaux que je lui apportais de la ville. Elle avait tant d'adresse et d'intelligence qu'elle faisait des tartines et qu'elle coupait des mouillettes aussi lestement que l'aurait pu faire une femme de Lisbonne ou de Londres. Assis vis-à-vis l'un de l'autre, à une petite table, nous faisions ensemble presque tous les jours de bons goûters. Elle me servait avec un soin, une attention, un zèle qui ne se ralentissaient jamais. Le cher petit animal me donnait toujours ce qui lui semblait le meilleur (34) ; or, le meilleur, dans son opinion, était le fruit le plus gros et le gâteau le plus ample, ne gardant pour elle que ceux qui,étant les plus chétifs, avaient moins de valeur à ses yeux.
A force de soins, je lui avais appris à déboucher avec adresse une bouteille au moyen d'un tire-bouchon, à bien nettoyer les verres, à mêler de l'eau dans son vin. Elle savait en même temps très bien qu'il fallait verser les liqueurs en moins grande quantité que le vin ordinaire. Bref, ces petits banquets avaient une sorte d'élégance dont on aurait eu lieu d'être surpris, si l'on avait su qu'ils avaient été disposés par un jeune animal qui jusqu'alors n'avait reçu d'autres leçons que celles de la nature.
Comme sa nudité me déplaisait, je m'amusai à la draper avec des châles de couleurs vives (35) que j'avais consacrés à son usage, et qu'elle serrait ensuite dans sa petite commode. Presque toujours je lisais ou je méditais en mangeant les fruits et les œufs qu'elle m'avait préparés ; et comme ma petite Jocko se croyait obligée de m'imiter sur tous les points, elle prenait de son côté un livre (36) que, comme de raison, elle tenait le plus souvent à rebours, ce qui lui était bien égal. Quand je tournais un feuillet, elle en tournait un de son côté ; elle plaçait le signet quand je plaçais le mien, fermait, posait son livre sur la table, et au premier signe elle enlevait tout, lavait les assiettes et les tasses avec la plus grande propreté, et replaçait chaque objet sur la tablette de sa petite cabane, sans rien casser, sans rien déranger.
Ces scènes si simples, mais en même temps si amusantes, se répétaient tous les jours sans jamais me lasser. Sitôt que j'avais fini mes affaires de la ville, je me rendais près de ma petite Jocko : là, je lisais, j'écrivais, comme si j'eusse été seul. Il est très rare que je ne trouvasse pas ma collation prête. Elle ne touchait à aucune des provisions que je laissais dans la cabane, avant que je lui en eusse fait don en les plaçant devant elle ; au reste, elle savait très bien distinguer ce qui lui appartenait en propre des choses que nous avions en commun ; elle avait ses petites nippes à elle, des bagues en verroteries, de petites boîtes, les châles avec lesquels je me plaisais à la vêtir quand j'étais près d'elle ; des mouchoirs de couleur dont j'ornais sa petite tête à la manière des créoles ; des pendants d'oreilles en girandole. Je me souviens à ce propos qu'elle cria beaucoup et fit bien de façons pour se laisser percer les oreilles ; elle se débattit, voulut s'échapper : il fallut se fâcher pour la réduire.
Sitôt que j'étais parti, elle se déshabillait, et ne reprenait ses vêtements que vers le temps où elle présumait, ou, pour mieux dire, où elle pressentait mon arrivée. Je lui avais apporté une de ces horloges de bois qu'on nomme coucous et qu'on fabrique dans la Forêt-Noire, espérant l'accoutumer à compter et à connaître les heures ; mais je ne pus jamais en venir à bout. Cependant on m'avait assuré que plusieurs individus des différentes espèces d'orangs étaient parvenus à compter jusqu'à cinq.
Une fois nos petites collations finies, et même le plus souvent en prenant mon thé, mon café avec elle, je rêvais, je composais des vers que j'écrivais ensuite. Jocko, ma fidèle imitatrice, ne manquait pas de son côté de s'emparer des plumes que j'avais jetées, et de barbouiller, d'un air bien grave, les petits morceaux de papier que j e lui abandonnais. Qu'eût dit un Européen témoin de ce bizarre tête-à-tête ? Eh bien ! ces pages brûlantes, ces vers passionnés, que le public a daigné accueillir avec tant d'indulgence, je les ai composés à côté de la femelle d'un sauvage et farouche pongo.
Une après-midi qu'heureusement j'arrivai quelques minutes plut tôt qu'à l'ordinaire, je ne trouvai point Jocko à l'entrée du bois ; je m'approche, j'écoute, j'entends des gémissements, des plaintes ; tout é coup succède un silence absolu. J'entre dans la hutte, j'aperçois la pauvre créature étendu sur son lit : ses chairs, déchirés en plusieurs endroits, étaient parsemées d'épines, et de petits fragments de pierres paraissaient s'y être incrustés.
Je la relève ; un instant je la crus morte, mais elle n'était qu'évanouie : je lui fis respirer et ensuite avaler quelques gouttes d'une eau spiritueuse. Lorsqu'elle fut revenue à elle-même, je crus comprendre par ses gestes ou qu'elle avait été renversée de la cime d'un arbre très élevé, ou qu'elle s'était meurtrie en tombant dans un précipice. Grâce à ses soins prévoyants, il y avait un reste de feu près de la cabane ; je fis chauffer du vin à la hâte, je lavai les plaies du cher petit animal ; elle ouvrit ses jolis yeux de gazelle et me regarda d'un air caressant. Je pilai des herbes entre deux cailloux ; j'en fis des espèces de compresses, et je me mis en devoir de les appliquer sur ses blessures qui, à ma grande surprise, étaient déjà remplies, du moins, en partie, d'herbes vulnéraires mâchées par elle (37) ; mais elle n'avait point extrait les épines et tous les corps durs, sans doute à cause de la douleur que lui eût fait éprouver cette opération. Je m'en occupai avec soin et avec le plus de délicatesse qu'il me fut possible ; j'attachai fortement les compresses au moyen de diverses ligatures faites avec des mouchoirs que je conservais dans la commode de Jocko. Je renouvelai les feuilles de bananier dont j'avais recouvert son petit lit, et qui étaient souillées de sang. Je me tins ensuite près de ma petite malade qui exhalait des plaintes si douces, mais en même temps si douloureuses que, malgré moi, mes yeux se mouillèrent de larmes (38).
J'aurais donné tout au monde pour passer la nuit auprès d'elle ; mais je craignais d'inquiéter mes gens, et je n'osai me livrer à ce premier mouvement. La pauvre créature avait une fièvre brûlante ; je tâtai son pouls à plusieurs reprises, et elle me tendait son petit bras avec une grâce charmante (39). Enfin lorsqu'il fallut la quitter, je plaçai près de son lit un des pliants ; je posait dessus plusieurs verres d'eau rougie ; je lui préparai de l'eau panée légèrement sucrée, et je lui fis signe de prendre alternativement les deux breuvages. Je lui arrangeai des oreillers de mousse recouverts de feuilles de bananiers. Elle tenait ma main, la rapprochait d'elle comme pour me dire de ne pas l'abandonner.... ; ensuite elle me léchait le bout des doigts avec sa petite langue couleur de rose, et alors brûlante. Lorsque je sortis de la cabane, elle poussa un profond soupir. Le lendemain, j'étais près d'elle à la pointe du jour.
Je trouvai la pauvre Jocko sans fièvre mais si faible, qu'elle ne put se lever de son lit de repos. Elle avait très bien compris ce que j'avais cherché à lui faire entendre ; elle s'était servie, pour étancher la soif ardente que la dévorait, de toutes les boissons que j'avais posées sur le pliant, car il n'en restait pas une seule goutte. De son côté, elle me faisait des signes alors entièrement inintelligibles pour moi, mais qui me furent, comme on va le voir, expliqués plusieurs jours après. Elle me montrait ses blessures, jetait un cri douloureux ; ensuite elle tournait ses regards vers la petite commode que je lui avais donnée.
N'osant lever encore les appareils, dans la crainte de la faire trop souffrir en les détachant, et d'accroître ainsi son extrême faiblesse, je lui donnai un peu de biscuit trempé dans de l'eau rougie ; elle baisait le bout de mes doigts : c'était une de ses caresses ordinaires quand elle était contente. Enfin je la quittai après avoir rempli ses verres d'eau légèrement sucrée, dans laquelle j'avais mêlé quelques gouttes de vin ; je sortis, et il est inutile d'ajouter que je revins l'après-midi. Elle dormait ; je respectai son sommeil, et lorsqu'elle s'éveilla, elle parut vivement émue en me voyant à ses côtés.
Comme il s'était écoulé vingt-quatre heures depuis le premier pansement, je crus pouvoir visiter ses blessures. Je fis chauffer de l'eau, j'humectai les compresses. Heureusement la pauvre Jocko n'avait que des légères contusions à la tête, et, quoique ses chairs fussent cruellement déchirées, je ne remarquai aucune fracture. J'avais apporté avec moi de l'agaric et de la charpie ; je posai de nouvelles compresses, je fis de nouvelles ligatures. La fièvre était entièrement tombée ; je graduai par degrés la nourriture. Jamais de viande, je ne voulais pas qu'elle connût cet usage funeste ; mais des végétaux, des fruits cuits, de petits gâteaux. Elle se mourait de faim : toutefois, dans la crainte de lui faire du mal, je ne satisfais qu'à moitié son appétit. Qui le croirait ? Lors même qu'elle était en pleine santé, je laissais dans la butte plusieurs comestibles, je lui faisait mon signe ordinaire de défense, et le lendemain, je trouvais tout dans le même état, sans quelle eût osé y toucher (40).
Insensiblement elle paraissait se rétablir, et, au bout de quelques jours, elle put se tenir sur son séant. Cependant sa faiblesse était encore si grande, qu'ayant voulu se lever, elle retomba sur sa couchette. Je m'assis à côté d'elle ; elle appuyait de temps en temps sa petite tête sur mon épaule, tandis que je lisais ; et quand elle avait faim, elle avançait et secouait ses deux petites pattes en les ramenant vers elle. Enfin, le jour suivant, je m'avisai de porter avec moi une guitare, tant pour la divertir que pour observer l'effet que je produirais sur elle (41). D'abord elle eut peur, surtout lorsqu'elle eut fait vibrer les cordes avec ses doigts ; elle les retira précipitamment, elle regarda d'un air curieux et inquiet derrière la guitare, ensuite en dedans, et, selon son usage, tourna sur moi des regards interrogateurs.
Je retirai alors l'instrument de ses mains et m'accompagnai en chantant une barcarolle vénitienne, ensuite la jolie romance de Raph *
Solitario bosc'ombroso, A te vien l'afflitto cuore.
* Antoine Raph ou plus correctement Raff, né en 1714, a Gelsdorf, dans le duché de Juliers, mort à Munich, le 28 mai 1797. Il est considéré comme le plus habile chanteur allemand du XVIIIe siècle. Cette même romance Solitario bosco qui fit sur Jocko une telle impression n'en produisit pas une moindre sur une princesse napolitaine, ainsi qu'on le voit par le récit suivant,, que nous trouvons dans la Bibliographie des musiciens, par F.-J. Fétis. « La princesse Belmonte-Pignatelli, après la mort de son mari, était en proie à une douleur sombre et muette qui faisait craindre pour sa vie : un mois s'était écoulé sans qu'elle proférât un mot ou versât une larme. Chaque soir on la portait dans ses jardins, les plus beaux de toutes les villas qui environnent Naples ; mais ni le plus beau site, ni le charme des soirées de cet heureux climat ne produisaient en elle les émotions d'attendrissement qui seuls pouvaient lui sauver la vie. Le hasard conduisit Raff dans ces jardins au moment où la princesse y était couchée sur un lit de repos ; on le pris d'essayer l'effet de sa belle voix et de son talent sur les organes de la malade ; il y consentit, s'approcha du bosquet où reposait Mme de Belmonte, et chanta la canzonette de Rolli:
Solitario bosc'ombroso, A te vien l'afflitto cuore, Etc.
« La voix touchante de l'artiste, l'expression de son chant, la mélodie simple et douce de la musique, et le sens des paroles adapté aux circonstances, aux lieux, à la personne, produisirent une impression si puissante, un effet si salutaire que la princesse versa des larmes qui ne s'arrêtèrent point pendant plusieurs jours et qui la sauvèrent d'une mort inévitable. » (T. 7, p. 337). (Note de l'édit.)
Non, je ne puis peindre sa surprise et son ravissement : tous ses sens paraissaient suspendus, elle respirait à peine. Elle se mit à genoux, croisa ses petites pattes, les éleva vers moi comme pour me supplier de continuer, et quand j'eus cessé de chanter, elle écoutait encore.
Tout à coup, se réveillant comme d'un songe, elle se lève avec précipitation, se frappe le front, court à sa petite commode, ouvre le tiroir qu'elle m'avait indiqué par ses signes, quelques jours auparavant, et elle m'apporte, ô surprise ineffable ! plusieurs coquillages de divers couleurs, et vingt-neuf ou trente des plus gros diamants que j'eusse vus de ma vie (42), tels, enfin, que ceux qui se trouvent au pied et dans les crevasses des monts Orixa.
Ici l'Européen avide prévalut sur l'homme de la nature et se montra dans toute sa basse avarice. Je saisis Jocko entre mes bras, je la serrai contre ma poitrine, je l'embrassai avec transport ; j'approchai tour à tour les diamants de mes lèvre pour lui exprimer ma satisfaction, en imitant son geste favori, j'étendis mes mains vers elle en les secouant, comme elle avait coutume de le faire quand elle demandait naïvement que je lui donnasse des biscuits, des gâteaux ; puis je m'avançai vers la porte en la prenant par le bras. Elle me regarda d'un air étonné, et voyant que je récidivais ce geste moitié suppliant, moitié impératif, elle prit un air triste, pencha sa tête sur sa poitrine, me montra ses blessures, s'assit à terre et appuya d'un air consterné son front sur le bord de sa couchette.
Je la relevai, je lui donnai quelques unes des friandises qu'elle affectionnait le plus, je lui fis boire un peu de crême de vanille, alors de lui rendre des forces ; je la fis asseoir, et je me remis, quoique extrêmement troublé, à chanter des notturni en m'accompagna de ma guitare, ce qui rendit à la naïve créature ses premières impressions et son ravissement.
Gens du monde, philosophes d'un jour, amis prétendus de la nature, un homme jouer des barcaroles pour divertir la femelle d'un pongo, quelle dégradation ! Et moi je m'honorais de mes soins pour elle ; je croyais, en procurant à ma pauvre petite amie malade quelques moments de douceur, et de jouissances innocentes, expier, du moins en partie, les mouvements de sordide avarice que je n'avais pu réprimer.
En moins de quinze jours, Jocko fut entièrement guérie ; nous reprîmes nos collations du soir, nos promenades, j'allais presque dire nos lectures, car ainsi que je l'ai dit plus haut, lorsque je prenais un livre, elle courait vite chercher le sien et imitait tous mes mouvements avec la plus scrupuleuse exactitude. Enfin, après avoir mangé des œufs frais et consommé nos sucreries, nos petits gâteaux, elle me regardait d'un air timide, et sur mon plus léger signe, elle courait chercher ma guitare, me la présentait : je jouais, je chantais un air ou deux, et son ravissement était toujours le même. Dès que j'avais fini, elle venait se mettre à genoux et léchait le bout de mes doigts ; ensuite elle desservait et rangeait tout avec une dextérité et une propreté admirables.
Persévérant, comme on s'en doute bien, dans mon ambitieuse avarice, je lui faisait voir quelques-uns des diamants qu'elle m'avait apportés ; je les basais devant elle, je les caressais de la main, je les suspendais à mon habit, ensuite je les serrais dans mes poches avec un soin affecté espérant par mes gestes lui faire comprendre mes avides désirs. Il paraît que la chère petite créature m'entendait fort bien, car aussitôt elle penchait la tête et prenait un air consterné.
Enfin un jour, quoique je fusse venu un peu plus tard qu'à l'ordinaire, je ne la trouvai point dans la cabane : rien de prêt au dehors. Presque toujours la table était arrangée ; elle avait soin d'allumer le feu dans une clairière située à quelques pas de la hutte, et de poser nos deux siéges à la place accoutumée. Je fus un peu inquiet et j'attendis sur la lisière du bois, en regardant avec anxiété à droite et à gauche. Au bout d'une demi-heure, je la vis accourir ; elle était essoufflée et paraissait excédé de fatigue : elle tomba à mes pieds privée de sentiment. Son bras droit était chargé d'un paquet qui me parut assez pesant, et qui était recouvert de feuilles de bananier ; je m'en saisis : l'effort qu'il fallut employer pour le détacher de ses bras la fit revenir à elle même ; elle se jeta dessus, arracha les feuilles. O nouvelle surprise ! Je faillis à mon tour de me trouver mal, lorsque après m'avoir présenté de magnifiques coquillages de diverses couleurs, que l'innocente créature paraissait préférer à tout le reste, j'aperçus une quantité de diamants au moins triple de la première. Je relevai ma pauvre Jocko qui était palpitante et à moitié suffoquée, soit par la fatigue qu'elle avait éprouvée, soit par la rapidité de sa course. J'avais peine à comprimer mes mouvements. Le présent, le passé, l'avenir refluaient à la fois sur mon cœur. O vous qui lisez ceci, que n'êtes-vous au courant de ma vie sensible ! Peut-être seriez-vous convaincus que l'Européen avide ne jouait ici que le rôle secondaire. Je m'arrête ; ce ne sont pas mes mémoires que j'écris, mais une simple anecdote, une seule circonstance de ma vie, assez importante à la vérité, puisqu'elle n'a pas médiocrement contribué à changer le cours de mes destinées.
Lorsque la pauvre Jocko eut consulté mes regards et lu dans mes yeux la joie vive, le dirai-je, l'espèce d'exaltation que j'éprouvais, elle secoua ses petites pattes et me demanda à manger. Rien n'était préparé, mais j'avais toujours bonne provision de fruits secs, de confitures, de gâteaux et des vins sucrés qu'elle préférait même aux liqueurs les plus fins. Elle mangea et but avec avidité. Cette fois-ci elle n'était point blessée ; mais en l'examinant je trouvai sur son corps plusieurs contusions ; ses chairs étaient froissées en divers endroits. Enfin, après s'être assise sur son pliant qui était moins élevé que le mien, elle arrangea sa tête sur ma poitrine sur ma poitrine et s'endormit d'un profond sommeil ; je dis profond et non paisible, car elle paraissait agitée et exhalait de sourds gémissements.
Absorbé dans mes réflexions, j'étais triste et pensif ; quelques larmes s'échappèrent de mes yeux et tombèrent sur le front de Jocko endormie. Je venais de recevoir des lettres de Lisbonne qui me faisaient présumer mon prochain rappel ; de douloureux souvenirs m'attendaient dans ma patrie. Que faire alors de ce cher petit animal, qui me donnait des marques si touchantes de son attachement ? J'avais presque oublié que la pauvre Jocko n'appartenait que par un fil imperceptible à l'espèce humaine ; je la considérais comme une jeune sauvage dont je ne pouvais me faire entendre que par des gestes et des signes, la seule langue primitive, la seule langue universelle, quoi qu'en disent nos orgueilleux hébraïsants. Ce n'était point un être semblable à moi, mais c'en était l'intéressante copie (43).
La série d'observations qu'elle m'avait suggérées favorisait mon système sur l'instinct des animaux, cette partie si philosophique de l'histoire de la nature. J'avais toujours considéré ces observations, à la fois si chères et si utiles à quiconque s'occupe de la recherche de la vérité, comme un des objets les plus dignes de fixer l'attention des êtres pensants et sensibles, enfin, comme un des plus piquants chapitres du grand livre de la nature.
Combien de fois j'avais regretté que la pauvre Jocko fût privée du don de la parole (44), et qu'elle n'eût d'autre langage que ses regards si expressifs ou quelques cris, à la vérité assez variés ! J'avais à plusieurs reprises examiné et pressé avec mes doigts les bords de cette espèce de mandibule intérieure qui formait une poche de chaque côté de la partie interne de ses joues, et je cherchai à lui faire prononcé son nom. Elle devina sans peine mon intention et fit des efforts incroyables, mais ce fut en vain ; elle ne put parvenir qu'à proférer la voyelle qui s'y trouve répété deux fois, et les deux voyelles qui se trouve dans le mien ; je me souviens même que ce faible essai me causa une émotion très vive, mais elle fut de peu de durée.
Je reviens à la scène des diamants et à l'assoupissement du cher petit animal épuisé de fatigue. Jocko éveillée resta quelques instants engourdie, et paraissait souffrir des douleurs assez vives dans tous les membres. Enfin elle alla, selon son usage, chercher ma guitare, en me regardant avec une expression plus touchante qu'à l'ordinaire : on eût dit qu'elle devinait ma pensée et qu'elle savait combien elle avait part à ma tristesse. En effet, que faire ? que résoudre ? L'abandonner était une barbarie dont je me sentais incapable ; l'emmener avec moi c'était sans doute le parti qu'il fallait préférer ; mais que d'inconvénients ! Arrivée en Europe, de longtemps je ne pouvais m'occuper d'elle : soit que je la plaçasse dans ma maison de ville, soit que je l'envoyasse à la campagne, elle eût été nécessairement négligée, si même elle ne fut devenue le jouet des domestiques ; enfin, je ne prévoyais pour elle que des dégoûts ou des malheurs, et la pauvre créature était la source de la fortune immense dont j'allais jouir.
Qui le croirait ? et je l'avoue à ma honte, j'essayai par tous les moyens possibles de lui faire comprendre que je voulais connaître le lieu où elle avait puisé tous ces trésors ; mais je ne pus y réussir, et je fus assez dur pour lui marquer de l'humeur, même pour faire succéder les menaces aux caresses. O Europe ! tes froids poisons altèrent et dominent les plus doux sentiments du cœur, semblables à l'écume qui se présente toujours à la surface !
Mes inquiétudes sur le sort qui attendait ma pauvre Jocko prenaient de jour en jour de nouvelles forces. Je la regardais avec attendrissement ; je ne chantais plus que des airs mélancoliques. Depuis plusieurs jours, soit crainte de ce qui m'attendait dans ma patrie, soit peut-être le souvenir des peines qui m'avaient déterminé à la quitter pour me réfugier sur un autre hémisphère, j'étais d'une tristesse qui frappait tout le monde.
Enfin, le 28 décembre 18..., tourmenté par une secrète inquiétude, je sors de chez moi plut tôt qu'à l'ordinaire ; je m'étais muni de gâteaux et de fruits confits que je savais être les plus agréables à ma petite Jocko ; je marchais assez vite ; j'étais impatient d'arriver. De loin j'entends un bruit qui m'était inconnu..., je hâte ma marche. O terreur ! J'aperçois des traces de sang ; je m'élance, je voix un affreux serpent, que je crus d'abord de l'espèce de ceux qu'on nomme Boa ; mais je reconnus plus que c'était une de ces grandes couleuvres de Java (45), longues de huit à neuf pieds, et auxquelles on a donné le nom de jaune et bleue, à cause de leur peau tigrée et divisée en carreaux traversés de raies d'un azur éclatant. Le monstre était aux prises avec la malheureuse créature, dont les membres étaient déchirés et le corps couvert de larges blessures, d'où s'échappaient des ruisseaux de sang. Je ne marchais jamais qu'armé d'un pistolet à deux coups. Je vise droit à la tête de l'affreux reptile : je le blesse ; il s'arrête, se replie, se redresse pour s'élancer sur moi ; mon second coup le met en fuite : il va expirer à un quart de mille de l'endroit où se passait cette scène de mort.
Jocko était tombée à terre évanouie, non seulement à raison de la perte de son sang, mais à cause de la terreur que lui avait occasionnée le bruit du pistolet, sans parler de celle que la vue seule d'un serpent cause naturellement aux individus de son espèce (46). Je me précipite sur elle, je l'emporte dans sa cabane, je l'étendis sur son lit. Elle avait, selon son usage, préparé du feu au lieu accoutumé : je lavais ses plaies ; elles étaient affreuses. Je pilai, comme la première fois, des herbes entre deux cailloux ; j'en composai une espèce de charpie ; je fis des bandelettes avec mon mouchoir ; je comprimai fortement les blessures de l'infortunée ; j'arrêtai le sang : insensiblement je la fis revenir à force de cordiaux et de sels. Sa pâleur était telle qu'à sa couleur légèrement bistrée avait succédé une teinte blanchâtre (47) qui la faisait ressembler à un individu de notre espèce, à une fille de quatorze ans. Elle ouvre les yeux, les referme et pousse quelques faibles gémissements. Non, non, je ne craindrai point de l'avouer, mes larmes coulèrent avec abondance. Je tâtais le pouls de ma chère Jocko, j'en suivais avec avidité tous les battements ; à leur accélération, à leur intermittence, je prévis que dans peu d'instants elle serait saisie d'une fièvre violente.
Si j'avais été de sang-froid ; mais hélas ! pouvais-je être calme dans une telle occurrence ? si, dis-je, j'avais pu m'occuper d'autre chose que de mes espérances et de mes craintes sur le sort de cette intéressante créature, quelle foule d'observations curieuses j'aurais été à portée de faire en examinant avec attention tout ce qu'éprouvait la pauvre victime. La terreur, l'espoir, un affreux délire.... Et on leur refuse une âme ! Philosophes, disons mieux, docteurs impies, vous osez borner et circonscrire l'œuvre du suprême Créateur ! Jocko, privée du don de la parole, n'articulait aucun son intelligible, du m oins pour nous ; mais que de sentiments divers se peignaient dans ses regards ! J'en étais accablé. Elle souffrait des douleurs inouïes, et ses yeux, animés par la fièvre, suivaient avec avidité tous mes mouvements. Que d'effroi ils exprimaient lorsque je m'éloignais un instant !
Comment la quitter ? Cependant je ne pensais pas sans anxiété à la douleur, au désespoir même de mes gens, de tous mes amis si, au lieu de revenir à l'heure accoutumée, je passais la nuit dans la forêt. Eh bien ! qu'on me blâme d'avoir donné la préférence à la femelle d'un pongo, mais je n'ai dans ma conscience à me reprocher qu'un seul instant d'incertitude et d'hésitation.
J'avais fait un pas vers le seuil de la cabane, un cri douloureux de Jocko me ramena vers elle ; je lui donnais quelques calmants dans l'espoir de diminuer les douleurs atroces qu'elle endurait. Un moment je la crus sauvée : ses convulsions cessèrent, elle parut respirer avec moins d'effort, la fièvre tomba comme par une sort d'enchantement. — Jocko ! Jocko ! m'écriai-je. Elle tourna vers moi sa petite tête, me regarda d'un air caressant et doux, fit un geste comme si eût voulu se lever, retomba sur son lit et exhala son dernier soupir....
Trois jours après, je partis pour l'Europe.
Decorative thing goes here
PREUVES
(1) Au rapport de don Félix d'Azara, quelques personnes disent que le caraya, singe qui, selon lui, appartient à la famille des alouates, surpris loin de sa retraite et se trouvant sans refuge, se couche par terre, joint les mains et semble demander merci. (Essai sur les quadr. du Paraguay.) — Cette faculté d'exprimer par les regards et les gestes ses diverses affections, se remarque même dans les singes d'une plus petite espèce: « Lorsque par un coup de fusil, dit M. Audebert, on a démonté un coaïta, il étend ses bras vers son ennemi, le regarde, en faisant remuer ses mâchoires et semble lui demander la vie, Ces gestes, ces regards d'un animal si semblable à l'homme, portent le trouble dans l'âme d'un chasseur peu accoutumé à cette proie, et ce sentiment est si vif, que plusieurs ont renoncé à cette espèce de chasse.... En effet,, qu'on se représente un singe couché sur l'herbe teinte de son sang luttant contre la mort, étendant ses petites mains vers celui qui l'a blessé, et tournant vers lui sa face presque humaine ; qu'on se figure les yeux mourants de cet animal qui, par leur expression touchante, semblent reprocher à son ennemi les douleurs qu'il ressent et sa perte prochaine. » Histoire des singes, Coaïta. — Un scène de ce genre détermina le voyageur Stedman à ne plus aller à la chasse de ces animaux. — M. le chevalier Foucher d'Obsonville, dans une note communiquée à M. de Buffon, parle avec complaisance de la gentillesse d'un petit loris ou thevangue qu'il avait élevé. « Les marques de sa sensibilité, dit-il, consistaient à prendre le bout de ma main et à le serrer contre son sein en fixant ses yeux à demi ouverts sur les miens. » Hist. nat., 2 addit. à l'art. Loris.
(2) « L'orang-outang a toutes les dents, même les canines, semblables à celles de l'homme. » Buffon, Hist nat., art. Orang-outang.
(3) Les naturalistes s'accordent assez généralement à dire, que le pongo ou orang-outang de la plus grande espèce, est à peu près de la taille d'un homme ordinaire. G. Cuvier, Tabl. de l'Hist. nat. des anim.
(4) « Il existe, dit Linné, si peu de différence entre le singe et l'homme qu'on n'a pu trouver encore d'observateur assez habile pour déterminer la limite qui les sépare. Syst. nat. — En effet, il serait assez difficile au premier coup d'oeil de ne pas confondre avec des hommes les singes de Guinée, que Peiresc décrit sous le nom de barris, auxquels leur barbe blanche et peignée, leur démarche lente et mesurée,, donnent, dit-il, un air vénérable. Voyez Gassendi, Vit. Peiresc. — « Si l'on ne devait juger que par la forme, observe M. de Buffon, l'espèce du singe pourrait être prise pour une variété dans l'espèce humaine. » Toutefois notre Pline français ajoute que le singe diffère beaucoup de l'homme par le tempérament. « L'homme, dit-il, peut habiter tous les climats ; il vit, il multiplie dans ceux du Nord et dans ceux du Midi ; le singe a de la peine à vivre dans les climats tempérés, et ne peut multiplier que dans les pays les plus chauds. » Hist. nat.m, art. Singes.
(5) Le mot orang-outang, qui signifie homme sauvage, n'est, comme on le sait, qu'un terme générique. « Ce nom d'hommes sauvages, dit M. Relian, leur vient du rapport qu'ils ont extérieurement avec l'homme, surtout dans les mouvements, et d'une façon de penser qui leur est particulière, et qu'on ne remarque pas dans les autres animaux. » Lettre à M. Allamand, Batav., 1770, rapportée par M. de Buffon, Hist. nat., addit. à l'art. Orang-Outang. — On a reconnu de tout temps cette extrême ressemblance de l'orang-outang avec l'homme. « Les diverses espèces de singe, dit Pline, sont, de tous les animaux, ceux qui, par leur conformation, ressemblent le plus à l'homme. Elles sont distinguées entre elles par leur queue. Le singe est d'une adresse merveilleuse.... Mucien écrit que des singes ont même joué aux échecs, l'usage leur ayant appris à distinguer les pièces de l'échiquier. » Plin., Hist. nat. — M. de Buffon n'a pas craint d'avancer que « l'orang-outang pourrait être considéré comme le premier des singes et le dernier des hommes. » Hist. nat., art. Singes.
« L'orang-outang, dit M. Ch. Bonnet, est si semblable à l'homme, que l'anatomiste qui les compare, croit comparer deux individus de même espèce, ou du moins du même genre ; et frappé des ressemblances si marquées et si nombreuses qu'il découvre entre ces deux êtres, il n'hésite pas à placer l'orang-outang immédiatement après le grossier Hottentot. » Contemp. de la nature.
Ce n'est pas seulement par les formes extérieures que l'orang-outang offre des ressemblances frappantes avec l'homme : il ne s'en approche pas moins par sa démarche et par ses mœurs. « J'ai vu, dit Bontius, quelques individus des deux sexes qui marchaient sur deux pieds, principalement une femelle qui se dérobait avec pudeur aux regards des hommes qu'elle ne connaissait pas, cachant son visage avec ses mains (s'il est permis de parler ainsi), versant des larmes abondantes, poussant des gémissements, enfin exécutant toutes les actions humaines de manière qu'on eût dit qu'il ne lui manquait que la parole.... On le nomme l'orang-outang, c'est-à-dire homme des bois. »
(6) Ce singe, nommé chimpanzé dans quelques parties de l'Afrique, et jocko ou enjocko par les habitants du Congo, est, selon l'observation de M. Ans. Desmarets, beaucoup plus voisin de l'homme par la proportion de ses bras, que l'orang-outang proprement dit. V. Dict. d'hist. nat.
(7) Au rapport d'André Battell et de quelques autres voyageurs, « les pongos couvrent leurs morts de feuilles et de branches, ce que les nègres regardent comme une espèce de sépulture. » — Le pongo, dont la taille égale celle d'un homme de la plus haute stature, est d'une force surprenante, et telle que, si l'on en croit les voyageurs, dix hommes ne suffisent pas pour venir à bout d'un seul d'entre eux. Aussi combattent-ils avec avantage les hommes qu'ils rencontrent dans les endroits écartés. Armés d'une massue, ils attaquent même les éléphants et sont quelquefois vainqueurs. On les voit souvent enlever des nègres, et surtout des négresses ; mais ils les traitent avec douceur. Battell, que j'ai cité plus haut, parle d'un petit nègre qui lui appartenait et qui fut enlevé par un pongo : cet enfant passa un an entier au milieu de ces singes, et à son retour, il assura qu'ils ne lui avaient fait aucun mal.
(8) « Les singes, dit M. de Buffon, ne mangent rien sans l'avoir flairé auparavant. » — M. Virey observe également que l'odorat et le goût sont très développés chez les singes. « Ces deux sens, ajoute-t-il, prévalent sur les autres, et dirigent leurs appétits. » Dans sonVoyage en Afrique, M. Levaillant parle d'un singe qu'il a célébré sous le nom de Kees. « C'était, dit ce voyageur, un singe de l'espèce si commune au Cap sous le nom de bawian (babouin ou papion). Il était très familier, et s'attacha particulièrement à moi. J'en fis mon dégustateur. Lorsque nous trouvions quelques fruits ou racines inconnus à mes Hottentots, nous n'y touchions jamais que mon cher Kes n'en eût goûté ; s'il les rejetait, nous les jugions ou désagréables ou dangereux, et nous les abandonnions. » — M. Levaillant cite encore un assez grand nombre de faits qui prouvent la sagacité et la finesse de l'odorat de son singe Kees, entre autres le suivant : « L'eau, dit-il, devenait moins abondante.... J'aperçois, Kees, qui tout à coup s'arrête, et qui, portant les yeux et le nez au vent sur le côté, se met à courir, entraînant tous mes chiens à sa suite, sans qu'aucun d'eux donnât de la voix.... Je pique des deux pour les joindre. Que je fus étonné de les trouver rassemblés autour d'une jolie fontaine, éloignée de plus de trois cents pas de l'endroit d'où ils venaient de détaler ! » Ibid.
(9) « Les singes, dit Linné, sont généralement soupçonneux ; ils conservent le souvenir des bons et des mauvais traitements, etc. » Syst. nat. — Allamand observe que « le singe nommé Rolloway, caressant pour son maître, se défie des étrangers, et se met en posture de défense lorsqu'ils veulent s'en approcher ou le toucher. » Addit. à l'Hist. nat. de Buffon.
(10) « Les singes expriment leurs affections par un petit cri très doux, et qui, dans les sapajous, ressemble au son de la flûte ; ce n'est que lorsqu'ils sont en colère qu'il font entendre leur voix aigre et déchirante. » Audebert, Hist. des singes. — On remarque ce cri doux et modulé dans plusieurs autres espèces de singes ou d'animaux analogues, tels que le pinche, la thévangue ou loris, etc. — M. Foucher d'Obsonville dit, en parlant d'un animal de cette dernière espèce, « qu'il faisait quelquefois entendre une sorte de modulation ou de sifflement assez doux. Je pouvais aisément, continue-t-il, distinguer le cri du besoin, du plaisir, de la douleur, et même celui de l'impatience. » Note communiqué à M. de Buffon.
(11) Au rapport d'Inigo de Biervillas, Voyages, les singes de Calicut savent fort bien casser les noix de coco, en manger l'amande, et boire la liqueur qu'elles contiennent. Il ajoute que les naturels du pays profitent de cette circonstance pour prendre ceux animaux vivants. On fait, dit-il, de petits trous dans les noix de coco : le singe ne manque pas d'y fourrer la patte pour achever de les ouvrir, et le chasseur le saisit avant qu'il ait eu le temps de se débarrasser.
(12) Les singes, comme la presque totalité des animaux quadrumanes, sont omnivores. Ils mangent avec plaisir des noix, des glands, des bulbes, des feuilles, de la salade, du pain, des œufs, etc. Toutefois, habitués à vivre sur les arbres dans les climats chauds, les fruits sont la nourriture qu'ils préfèrent, ils les cueillent et les portent à leur bouche à la manière des hommes. — M. Fréd. Cuvier, dans sa description de l'orang-outang observée à Paris en 1808, rapporte que « cet animal mangeait presque indistinctement des fruits, des légumes, des œufs, du lait, de la viande ; il aimait beaucoup, ajoute-t-il, le pain, le café et les oranges. » — « Lorsque l'orang-outang, dit Ch. Bonnet, ne trouve plus de fruits sur les montagnes ou dans les bois, il va sur les bords de la mer chercher une grosse espèce d'huître du poids de plusieurs livres, qui est souvent béante sur le rivage ; mais le singe circonspect, qui craint que l'huître, en refermant prestement sa coquille, ne lui saisisse la main, jette adroitement dans la coquille une pierre qui l'empêche de se refermer et qui lui permet de manger l'huître tout à son aise. — Parmi les singes à queue du genre des guenons, il en est qui mettent leur longue queue entre les pinces des grandes écrevisses, et dès que celles-ci la serrent, les singes les enlèvent prestement et vont les manger à l'écart. » Contempl. de la nature.
(13) « C'est, dit M. Vitrey, un spectacle bien amusant de voir, dans ces antiques et vastes forêts de la zone torride, les singes s'élancer d'un arbre à l'autre, se balancer suspendus aux branches, sauter et gambader, se grouper en mille postures ridicules, se faire mutuellement des agaceries, se battre ou s'amuser ensemble, etc. » Art. Singes, Dict. d'hist. nat.
(14) Les orangs-outangs et les autres singes, tels que les babouins, les sajous, etc. boivent avec plaisir du vin, de l'eau-de-vie, et d'autres liqueurs fortes. Voy. Buffon, Histoire naturelle. — Guillaume Rubruquis rapporte que, pour prendre les singes du Catay, on place à l'entrée de la caverne où ils se retirent des liqueurs fortes et enivrantes. « Ils viennent tous ensemble, dit-il, goûter de ce breuvage en criant chin-chin, et s'enivrent si bien qu'ils s'endorment, en sorte que les chasseurs les prennent aisément. » Relation traduite, par Bergeron, Voyage en Asie. — L'orang-outang dont parle Tulpuis buvait très adroitement dans un vase dont il saisissait l'anse d'une main, tandis que de l'autre il tenait le fond ; et quand il avait bu, il ne manquait pas de s'essuyer proprement les lèvres. — L'individu femelle, que l'on a vu à Paris en 1808, buvait également dans un verre en le tenant avec ses deux mains ; ensuite il lui arrivait quelquefois de prendre le mouchoir d'une dame de la compagnie, de s'essuyer les lèvres et de le rendre après s'en être servi.
(15) Personne n'ignore que les singes nommés Barris (simia troglotyes, Linné), les orangs-outangs, les pongos, les jockos sont conformés de manière à se tenir facilement debout. -- « Vêtus d'un habit, dit Gassendi, les singes nommés Barris se mettent sur-le-champ à marcher sur deux pieds. » Toutefois, selon l'observation de feu M. Daubenton, « le talon de l'orang-outang posant plus difficilement à terre que celui de l'homme, il court plus facilement qu'il ne marche, et il aurait besoin des talons artificiels plus élevés que ceux de nous souliers, si l'on voulait le faire marcher aisément et longtemps. » Encyclop. méthod., art. Orang-Outang. — « J'ai vu, dit M. de Buffon, un orang-outang présenter sa main pour reconduire les personnes qui venaient le visiter, se promener gravement avec elles et comme de compagnie. »
(16) « Le babouin à longues jambes, se nourrit de scarabées, de mouches et d'autres insectes qu'il saisit au vol avec beaucoup d'adresse. » Buffon.
(17) Les voyageurs les plus accrédités attestent que l'orang-outang et les singes de cette famille ont en général plus de pudeur que les autres animaux. On lit dans le Voyage aux Indes-Occidentales d'Henri Grose, que deux orangs-outangs, donnés à M. Horne, gouverneur de Bombay ne pouvaient souffrir qu'on les regardât avec trop de curiosité, et cachaient de leurs mains les parties que la modestie défend de montrer. — M. Relian, chirurgien à Batavia, parle de deux orangs-outangs mâle et femelle qu'il avait eu occasion d'observer. « Ils étaient tout honteux quand on les fixait trop. Alors la femelle se jetait dans les bras du mâle et se cachait le visage dans son sein, ce qui faisait un spectacle véritablement touchant. » — Cette pudeur naturelle se faisait remarquer dans la petite Jocko que l'on a vue à Paris en 1808. « Elle est, disent les rédacteurs du Journal de Paris, revêtue d'une redingote à la manière de nos dames, et lorsque quelqu'un entre dans sa chambre, elle prend un maintien réservé, se tient dans une posture très décente, et se couvre les jambes et les cuisses avec les pans de sa redingote. »
(18) On a vu plus haut que l'orang-outang, le pongo, le chimpanzé ou jocko, marchent sur deux pieds comme l'homme. Les plus célèbres voyageurs s'accordent à dire qu'afin d'assurer et d'affermir leurs pas dans cette position, ils tiennent ordinairement à la main un bâton qui leur sert en même temps pour se défendre et pour attaquer.
(19) Il est inutile de répéter ici tout ce que l'on a dit de la jalousie des singes, non seulement envers les individus de leur espèce et de sexe différent, mais aussi envers ceux de la nôtre. « Les papions que l'on voit dans nos ménageries, dit M. Audebert, poussent des cris horribles lorsqu'un des spectateurs fait mine de vouloir caresser une femme en leur présence. » — « J'ai vu à la Martinique, dit feu M. Moreau Saint-Méry, un babouin d'une espèce moyenne qui avait conçu une passion violente pour la fille de son maître.... A cet amour effréné se joignait une jalousie furieuse pour tous les hommes qui approchaient d'elle, et il semblait qu'il eût deviné qu'il en était un parmi eux dont elle ne recevait pas les vœux sans indifférence. Un jour que, pour mettre ce discernement du babouin à l'épreuve, elle consentit à se laisser baiser la main, l'animal fendit l'air de ses cris, tenta tous les efforts pour rompre la double chaîne qui le retenait, et manifesta une colère si effrayante, qu'on fit enfuir celui qui l'avait excitée, et qu'on prit dès lors la résolution de vendre le babouin à quelqu'un qui désirait le mener en France. » D. Fél. d'Azara, Essai sur les quadrupèdes du Paraguay. — M. Edwards, dans une lettre à M. de Buffon, raconte qu'un homme qui était allé avec une jeune fille voir un babouin ou papion enfermé dans une ménagerie, ayant embrassé cette jeune fille devant lui pour exciter sa jalousie, cet animal entra en fureur, empoigna un pot d'étain qui se trouva sous sa main, le jeta à la tête de l'homme et lui fit une large blessure. Voy. Buffon, Hist. nat. — Les singes femelles ne sont pas moins jalouses des femmes.
(20) Quelques écrivains ne font aucune difficulté d'attribuer à l'orang-outang la faculté de penser. « Si l'on en croit les voyageurs, dit Linné, l'homme sauvage, ou orang-outang, fait entendre un sifflement qui remplace chez lui la parole : doué de la faculté de penser, il croit que la terre a été fait pour lui, et qu'un jour il en sera de nouveau le maître absolu, etc. » Syst. nat. — En effet, les singes ont une mémoire excellente et se ressouviennent longtemps des bons et des mauvaises traitements. M. de Grandpré raconte qu'une jeune chimpanzé, espèce d'orang-outang, qui se trouvait dans un vaisseau, où elle donnait des preuves d'une rare intelligence, aidant le boulanger à faire le pain, etc., etc., mourut durant la traversée, victime de la brutalité du second capitaine, qui l'avait injustement et durement maltraitée. » Cet intéressant animal subit la violence qu'on exerçait contre lui avec une douceur et une résignation attendrissantes, tendant les mains d'un air suppliant pour obtenir qu'on cessât les coups dont on le frappait. Depuis ce moment, il refusa constamment de manger, et mourut de faim et de douleur, regretté comme un homme aurait pu l'être. » Voyage à la côte occidentale d'Afrique, t. 1.
(21) « Les mococcos, ou makis mococcos, ont une habitude naturelle assez singulière : c'est de prendre souvent devant le soleil une attitude d'admiration ou de plaisir. Ils s'asseyent, disent les voyageurs, et ils étendent les bras en regardant cet astre ; ils répètent plusieurs fois le jour cette sorte de démonstration, qui les occupe pendant des heures entières ; car ils se tournent vers le soleil à mesure qu'il s'élève ou s'incline. » Buffon, Histoire naturelle.
(22) La passion effrénée des singes mâles pour les femmes est un fait attesté depuis longtemps par les naturalistes et les voyageurs de tous les pays. Voy. Gassendi, Vit. Peir. — On a vu ci-dessus (note 19) à quelle violence se portent les singes, même dans l'état de captivité, contre les hommes qui leur inspirent de la jalousie.
(23) « Plus industrieux que les éléphants, les orangs-outangs savent se construire des cabanes de branches entrelacées et assorties à leurs besoins. » Ch. Bonnet, Contemplation de la nature. — « On assure, dit M. Audebert, que les pongos construisent des cabanes qu'ils couvrent de feuilles, et que les femelles, avec leurs petits, habitent ces espèces de nids. » Histoire naturelle des singes.
(24) « On n'est pas moins surpris, observe M. Ch. Bonnet, de voir l'orang-outang se coucher comme nous dans u lit qu'il a fait lui-même, poser sa tête sur le chevet, la ceindre d'un mouchoir, ajuster sur lui les couvertures, etc. » Contemplat. de la nat. — H. Grose, parlant de deux orang-outangs, mâle et femelle, donnés à M. Horne, gouverneur de Bombay, et dont j'ai déjà fait mention plus haut, dit que, dans le vaisseau sur lequel ils étaient embarqués, ils arrangeaient leur lit avec le plus grand soin. Voyage aux Indes-Occidentales, p. 329 et suiv. — On trouve des détails du même genre dans la description de l'orang-outang femelle observée en 1808 par M. Fréd. Cuvier. « Notre animal, dit-il, avait été habitué à s'envelopper dans des couvertures, et il en avait presque un besoin continuel. Dans le vaisseau, il prenait pour se coucher tout ce qui lui paraissait convenable pour cela ; aussi, lorsqu'un matelot avait perdu quelques hardes, il était presque toujours sûr de les retrouver dans le lit de l'orang-outang. » Description d'un orang-outang. — « Arrivé à Paris, il allait tous les jours chercher lui-même sa couverture dans le lieu où on la déposait,, la prenait sur ses épaules, revenait et grimpait sur les bras d'un petit domestique pour qu'on le portât dans son lit. » Ibid.
(25) « J'ai vu, dit M. de Buffon, un orang-outang verser lui-même sa boisson dans un verre. le choquer lorsqu'il y était invité. » Histoire naturelle.
(26) La femelle de l'orang-outang de Bornéo, dont Vosmaer nous a donné l'histoire détaillée, « aimait, dit-il, la compagnie sans distinction de sexe, préférant seulement ceux qui la soignaient et qui lui faisaient du bien. Souvent, lorsqu'ils se retiraient, elle se jetait à terre comme désespérée, poussant des cris lamentables. » Feuilles de Vosmaer, extraites par M. Buffon.
L'orang-outang, transporté de Bornéo à Paris en 1808 (voy. ci-après note 39), montrait une grande affection pour son maître. S'il ne le trouvait pas à table à sa place accoutumée, il poussait des cris de douleur, refusait de manger, se roulait par terre et se frappait la tête. « Ce besoin d'affection, dit M. Fréd. Cuvier, portait ordinairement notre orang-outang à rechercher les personnes qu'il connaissait et à fuir la solitude, qui paraissait beaucoup lui déplaire. » M. Fréd. Cuvier ajoute que ce jeune animal employait quelquefois toutes les ressources de son instinct pour se procurer le plaisir de la société. renfermé dans une chambre qui était séparée du salon de réunion par une porte fermée au moyen d'un pêne, et dont la serrure était trop haute pour qu'il pût y atteindre, il alla chercher une chaise, la traîna près de la porte, poussa le pêne, l'ouvrit, et parvint ainsi à entrer dans le salon.
(27) Les singes, principalement ceux des plus grandes espèces, sont monogames, c'est-à-dire qu'ils se contentent ordinairement d'une seule femelle, ou tout au plus de deux. « Leur union, dit M. Virey, semble une sorte de mariage : ils exigent la fidélité et sont horriblement jaloux. » Hist. de l'inst. des animaux. — Le mâle et la femelle ont l'un pour l'autre l'attachement le plus vif et l'expriment par des caresses et des complaisances réciproques. J'ai déjà parlé plus haut de deux orangs-outangs mâle et femelle que l'on avait envoyés en présent à M. Horne, gouverneur de Bombay. « La femelle, dit H. Grose, mourut sur le vaisseau, et le mâle, donnant toutes sortes de signes de douleur, prit tellement à cœur la mort de sa compagne, qu'il refusa de manger, et ne lui survécut pas plus de deux jours. » Voyage aux Indes-Occidentales.
(28) Ce genre de caresses ne se borne pas aux individus de leur espèce. « Ces animaux, dit le P. Lecomte, paraissent d'un naturel fort tendre ; il baisent les personnes qu'ils aiment avec des transports surprenants. » (Mémoire sur l'état présent de la Chine, t. II.) — M. Levaillant parle en grand détail des caresses qu'il avait reçues de son single Kees. « Souvent, dit-il, je le menais à la chasse avec moi ; que de folies et que de joie au moment du départ ! comme il venait baiser tendrement son ami ! » Voyage en Afrique, t. I.
(29) « Les orangs-outangs, dit Ch. Bonnet, vivent en société dans des bois, et sont assez forts et assez courageux pour en chasser les éléphants à coups de bâton. Ils osent même se mettre en défense contre des hommes armés. » Contemplations de la nature. — Les autres familles de singes, telles que les alouates, les malbroucks, les babouins, les singes rouges et bleus de la Gambie, les coaïtas, etc., forment également des sociétés plus ou moins nombreuses, composées chacune d'individus de la même espèce, et soumises aux ordres d'un chef qui est ordinairement le plus fort de la troupe. Les divers individus d'une famille ou d'une société se portent mutuellement secours, soit pour attaquer, soit pour se défendre au moindre cri de détresse, soit enfin pour piller. Ils établissent entre eux une sorte d'ordre, de subordination et de police dans les marches ou dans les diverses opérations ; punissent les négligents de peines corporelles et quelquefois même de mort. Virey, Hist. de l'inst. des animaux. « Nous étions souvent, dit M. Levaillant, visités en plein jour par des troupes considérables de bawians, singes de la même espèce que mon ami Kees. Ces animaux, étonnés de voir tant de monde, l'étaient encore plus de reconnaître un des leurs paisible au milieu de nous, et qui leur répondait en leur langage. » Voyage en Afrique. — Au rapport de D. Fél. d'Azara, les carayas, singes du Paraguay, vivent en familles composées de quatre à dix individus et conduites par un mâle. Ce chef se place toujours dans un lieu plus élevé, afin de veiller à la sûreté de la famille qu'il dirige, et qui attend, pour se mouvoir, que le chef se soit mis lui-même en mouvement. Essais sur les quadrupèdes du Paraguay. J'observai que ces singes ne sont pas les seuls qui se prêtent une assistance mutuelle. Les gros singes connus sous le nom de singes de la Cochinchine montrent le même courage et la même ardeur à secourir, au péril de leur vie, les animaux de leur espèce qui ont été blessés par les chasseurs. Voici quelques détails que donne à ce sujet un voyageur moderne, M. le capitaine Rey. « Nous commençâmes, dit-il, à gravir le défilé de Taysons, à cinq heures du matin, et avant d'être rendus à la station désignée pour le déjeuner, nous avions tué plus de cent singes de la grande espèce de ceux qui ne se trouvent que dans ce pays, et que l'on ne connaît que sous le nom de singes de la Cochinchine.... Je désirais ardemment pouvoir m'en procurer quelques jeunes en vie, pour les porter en France. Ce fut avec bien des difficultés que nous y parvînmes, et il fallut auparavant en détruire un grand nombre, parce que plus on en blessait, plus il en accourait aux cris de ces pauvres animaux.... Ce qu'il y a de plus singulière, c'est que les bien portants cherchaient toujours à emporter dans l'intérieur des bois les morts et les blessés. Trois jeunes que nous prîmes furent saisis sur le corps de leur père ou de leur mère, dont on eut beaucoup de peine à les détacher. » Je n'ose m'appesantir ici sur la cruauté des chasseurs qui, pour satisfaire une coupable cupidité, et souvent même un stérile amour-propre, ne craignent pas d'immoler des animaux si semblables à l'homme par leurs formes extérieures, leurs habitudes et le mutuel amour qu'ils ont les uns pour les autres.
Tous ceux qui ont étudié les mœurs des singes, connaissent l'ordre et l'espèce de tactique qu'observent ces animaux, lorsqu'il s'agit de piller un jardin, un verger ou un champ de cannes à sucre. Avant de commencer l'expédition, ils chargent un ou plusieurs d'entre eux de monter sur une éminence, afin de découvrir s'il n'y a point d'hommes qui puissent les troubler. Si les éclaireurs ne voient personne, ils avertissent par un cri le reste de la troupe, qui commence alors la maraude. Les uns cueillent les fruits, les cannes à sucre, etc., les dégustent et jettent ce qui ne leur convient pas ; d'autres, disposés en chaîne, se les passent de main en main afin de les mettre plus promptement en sûreté, tandis que quelques-uns, placés en sentinelle, sont chargés de donner, par le cri de boup, boup, boup, ou par quelque autre cri convenu, le signal de l'approche de l'ennemi. A ce cri d'alarme, les maraudeurs, et même les mères chargées de leurs petits, s'élancent sur les arbres, ou se sauvent dans les montagnes. Les sentinelles qui, par négligence, ont laissé surprendre leurs compagnons, sont sévèrement punis. Kolbe, Description du Cap de Bonne Espérance, assure même qu'elles sont mises à mort si quelqu'un de la troupe a été tué durant le pillage. — Ces détails sont attestés par un grand nombre de voyageurs et de naturalistes. — Stedman rapporte, comme témoin oculaire, la circonstance des vedettes placées par les singes pour protéger la maraude. « Ces animaux, dit-il, placent des sentinelles autour du lieu du pillage pour leur donner l'alarme, et j'ai été témoin moi-même de l'exactitude et de l'intelligence avec lesquelles ceux d'entre eux qui sont chargés de ce soin s'en acquittent. » Voyage à Surinam. — Le même voyageur fait mention d'une espèce de singes dont les individus vivent isolés et ne se réunissent point en familles. « Je dois parler, dit-il, d'un autre singe que je vis chez le colonel F....., et qu'à Surinam on nomme wanacoe.... Ce singe est le seul de son espèce qui ne soit pas sociable. On le trouve toujours seul. Cet animal solitaire est si méprisé par les singes des autres espèces, que continuellement ils le battent et lui volent sa nourriture. » et les singes aussi ont leurs parias !... Voyage à Surinam.
(30) Lorsque les pongos, dit André Battell, trouvent le matin les feux que les nègres allument durant la nuit, en voyageant au travers des forêts, on les voit s'en approcher avec une apparence de plaisir ; néanmoins ils n'ont jamais imaginé de les entretenir en y jetant du bois. » Purchas, Pilgrims. — Dans l'état de domesticité, les singes sont susceptibles d'apprendre à allumer le feu, à l'entretenir et à le surveiller, pour empêcher les accidents qu'il pourrait causer. La jeune chimpanzé dont j'ai rapporté la fin malheureuse, ci dessus, note 20, « avait, dit M. de Grandpré, appris à chauffer le four ; elle veillait attentivement à ce qu'il ne s'échappât aucun charbon qui pût incendier le vaisseau, jugeait parfaitement quand le four était suffisamment chaud, et ne manquait jamais d'avertir le boulanger, qui, de son côté, sûr de la sagacité de l'animal, s'en reposait sur lui, et se hâtait d'apporter sa pâte aussitôt que le singe venait le chercher, sans que ce dernier l'ait jamais induit en erreur. » Voyage à la côté occidentale d'Afrique.
(31) « L'orang-outang va chercher de l'eau à la fontaine, en remplit une cruche, la place sur sa tête, et l'apporte au logis. » Bonnet, Contempl. de la nat. Ce fait est également rapporté par plusieurs autres voyageurs.
(32) « J'ai vu, dit M. de Buffon, un orang-outang aller prendre une tasse et une soucoupe, l'apporter sur la table, y mettre du sucre, y verser le thé, le laisser refroidir pour le boire, et tout cela sans autre instigation que les signes ou la parole de son maître, et souvent de lui-même.... Je l'ai vu s'asseoir à table, déployer sa serviette, s'en essuyer les lèvres, se servir de la cuiller et de la fourchette pour porter à sa bouche. » — La femelle de l'orang-outang décrite par Vosmaer connaissait également l'usage de la cuiller et de la fourchette. « Quand on lui donnait des fraises, dit le naturaliste hollandais, c'était un plaisir de voir comme elle les piquait une à une, et les portait à sa bouche avec la fourchette. » — L'orang-outang femelle dont j'ai déjà fait mention plusieurs fois, mangeait très bien un œuf à la coque, pourvu qu'on lui préparât les mouillettes. Fréd. Cuvier, Descript., etc.
(33) « Dressé au service de la maison, l'orang-outang, sur un seul signe, ou à la voix de son maître..., rince les verres, sert à boire, tourne la broche, pile dans un mortier ce qu'on lui donne à piler, etc. » Ch. Bonnet, Contempl. de la nat. On voit également que les barris, les orang-outangs, et les autres singes de la même famille, apprennent à faire diverses sortes d'ouvrages, et à rendre à leurs maîtres tous les services qu'on peut attendre d'un domestique, qu'ils baillaient la chambre, nettoient les bottes, débouclent les souliers, etc. — La femelle de l'orang-outang dont parle Vosmaer savait très bien se tenir à table. « Après avoir mangé, dit ce naturaliste, elle prenait un cure-dent, et s'en servait au même usage que nous. » Feuil. de Vosmaer.
(34) Quoique ce soit en quelque sorte m'écarter de mon sujet, je ne puis m'empêcher de rapporter ici l'anecdote suivante dont je garantis l'authenticité. Un homme, tombé dans la plus affreuse misère, et qui était affligé d'un de ces caractères âpres que l'on blâme trop facilement dans les autres, et dont on a tort de s'enorgueillir soi-même, avait un chien, son seul ami. Ce pauvre animal, conduit par son instinct, avait pris l'habitude de s'arrêter à la porte de certains grands hôtels ; là, il cherchait fort adroitement avec sa patte, dans le trou perdu, des racines qu'entraînaient avec elles les eaux qui s'y précipitaient lorsque les marmitons lâchaient la bonde de la pierre d'évier. Il séparait les tronçons mordillés de ceux qui lui paraissaient les plus appétissantes, gardait les mauvais pour lui, et réservait les meilleurs pour son maître.
(35) M. Allamand parle d'une orang-outang femelle observée par M. Harvood. « Elle se couvrait volontiers, dit-il, avec des morceaux de toile, mais elle ne voulait point souffrir d'habits. » Voyez Buffon, Hist. nat. L'individu dont il est question ci-après, note 39, aimait à être couvert ; et, « pour cet effet, dit M. Frédéric Cuvier, il prenait toutes les étoffes, tous les linges qui se trouvaient près de lui. » Description d'un orang-outang. — M. G***, chez lequel cet intéressant animal a passé tout le temps qu'il est resté à Paris, depuis son débarquement jusqu'à sa mort, m'a écrit que le froid avait déterminé cette petit jocko à se laisser mettre un gilet de laine, une redingote, et même un pantalon ; mais souvent, lorsqu'elle se trouvait seule dans le salon, elle se mettait le plus près possible du feu, et ôtait tous ces vêtements.
(36) « J'ai vu, dit M. Audebert, un mangabey qui prenait un livre, le mettait sur une table et tournait les feuillets avec adresse, en faisant des grimaces, comme si le contenu de ce livre eût excité son indignation. » His. nat. des singes, art. Mangabey.
(37) On ne saurait trop s'étonner de l'adresse avec laquelle des singes, principalement les ouarines, sondent et pansent les blessures qu'ils reçoivent. voici ce que nous apprend à ce sujet Oexmelin, témoin oculaire. « Au moment où l'un d'eux est blessé, dit-il, on les voit s'assembler autour de lui, mettre leurs doigts dans la plaie et faire de même que s'ils la voulaient sonder. Alors, s'ils voient couler beaucoup de sang, ils la tiennent fermée, pendant que d'autres apportent quelques feuilles qu'ils mâchent et poussent adroitement dans l'ouverture de la plaie. Je puis dire avoir vu cela plusieurs fois, et l'avoir vu avec admiration. » Hist. des filibustiers.
(38) Le jeune sajou brun, élevé par M. Moreau-Saint-Méry, étant malade des suites de sa gourmandise, se prêtait volontiers aux soins qu'on prenait de lui. « C'était un spectacle touchant, dit M. Moreau-Saint-Méry, que celui de ce petit animal, surmontant à ma voix les douleurs atroces qu'il éprouvait, pour ouvrir la bouche et avaler l'huile que je lui donnais. »
(39) Un orang-outang mâle, enfermé dans un vaisseau, y tomba malade. « Il se faisait, dit M. de la Brosse, soigner comme une personne ; il fut même saigné deux fois au bras droit. Toutes les fois qu'il se trouvait incommodé, il montrait son bras pour qu'on le saignât, parce qu'il se rappelait que cela lui avait fait du bien. » Extrait du voyage de M. de la Brosse, rapporté par Buffon, Hist. nat. — La jeune jocko, qui arriva à Paris au commencement de mars 1808, était âgée alors de dix à onze mois. « Les fatigues d'un long voyage de mer, dit M. Frédéric Cuvier, et surtout le froid que cet animal éprouva en traversant les Pyrénées dans la saison des neiges, mirent sa vie à toute extrémité. En arrivant à Paris, il avait plusieurs doigts gelés, et il était atteint d'une fièvre hectique causée par des obstructions dans la rate, et par une toux qui donnait à peine l'espoir de le conserver encore quelques jours. » Description d'un orang-outang. M. G***, à qui cette petite Jocko avait été adressée à Paris, et qui lui avait donné le nom de mademoiselle des Bois, la surveillait avec la plus scrupuleuse exactitude. Un médecin venait la voir : dès qu'elle apercevait le docteur, elle le regardait avec des yeux caressants et lui tendait son petit bras pour qu'il lui tâtât le pouls. A force de soins, on parvint à rétablir un peu sa santé ; mais enfin elle succomba au bout de cinq mois.... Le jour de sa mort, M. G*** avait été forcé d'aller à la campagne avec sa famille, et l'avait laissée à une domestique de confiance. La pauvre des Bois, sentant sa fin prochaine, parcourut à diverses reprises tous les appartements, cherchant ses amis d'un air triste et inquiet ; enfin, désespérant de les trouver, elle vint gémir et mourir sur sa couverture qui était étendue dans le jardin. « A l'ouverture de son cadavre, on trouva, dit M. Frédéric Cuvier, la plupart des viscères désorganisés et remplis d'obstructions. » Descrip. d'un orang-outang.
(40) Acosta, cité par Stedman, assure avoir vu, dans la maison du gouverneur de Carthagène, un singe qui, lorsque son maître de lui ordonnait, allait chercher du vin au cabaret, portant d'une main le pot, et de l'autre l'argent, qu'il ne donnait jamais au marchant au marchand avant d'avoir reçu le vin. Quelquefois il lui arrivait, à son retour, d'être assailli par les enfants qui lui jetaient des pierres : alors il posait son pot à terre, recevait avec la main les pierres qu'on lui lançait, et les renvoyait si adroitement à ses assaillants, qu'il leur ôtait l'envie de l'attaque de nouveau. Ensuite il reprenait son pot, le rapportait fidèlement à la maison, et quoiqu'il aimât beaucoup le vin, il n'en buvait pas une seule goutte que son maître ne lui en eût donné la permission. Voyage à Surinam.
(41) Les singes sont en général très sensibles à la mélodie. Même, si l'on ose à la mélodie. Même, si l'on ose en croire l'illustre Gassendi, les grands singes de Guinée nommés Barris sont susceptibles d'apprendre à jouer habilement de la flûte, de la guitare et autres instruments. « Qui maximi sunt, et Barris dicuntur ... scitè ludere fistula, cithara, aliisque id genus. » Vita Pereisc. — Le comte Panoglorowski, exilé en Sibérie par le czar Pierre, et n'ayant pour toute société qu'un chien et un singe, s'occupa de l'instruction de ces deux animaux. Le chien apprit, dit-on, à jouer aux échecs, et le singe à jouer de la flûte. Journal de Paris du 1er septembre 1808.
(42) Ceux qui demandaient comment l'intéressante Jocko a pu apporter à son ami une si grande quantité de diamants, doivent se rappeler que, loin d'être exclusivement enfouis dans les mines de Raolconda, de Coulour et de Soumelpour, plusieurs diamants se montrent fréquemment à surface de la terre. Le savant M. Werner observe que l'on trouve au pied des monts Orixa, dans l'Inde, des diamants, qui, dit-il, ont été formés primitivement dans l'intérieur de ces montagnes, et qui ont été détachés par la suite. Voy. Nouvelle théorie de la formation des filons, etc. On sait aussi que les diamants de la mine de Soumelpour, laquelle tire son nom de celui d'un bourg situé sur la rivière de Gouel qui se jette dans le Gange, ne se trouvent point dans leur gîte natal, mais sont souvent disséminés dans le sable de la rivière, qui les a détachés de leur matrice. — Il est donc assez naturel de croire que Jocko avait trouvé, soit dans le sable et sur le bord d'une rivière, soit plutôt dans les fentes d'un rocher, les diamants dont elle fit présent à son ami.
(43) « Si l'orang-outang, dit M. Ch. Bonnet, n'est point un homme, il en est le prototype le plus parfait qui soit sur la terre. » Contempl. de la nat.
(44) Aucune des espèces des singes que nous connaissons n'est douée de la faculté de faire entendre des sons articulés et des paroles distinctes. — « Il est, dit M. G. Cuvier, physiquement impossible à l'orang-outang d'articuler aucun son, à cause d'un certain sac qui communique avec son larynx et qui rend la voix entièrement sourde. » Tabl. élément. de l'his. nat. On sait que les Nègres attribuent à la paresse le silence des singes, et qu'ils sont persuadés que si ces animaux ne parlent pas, c'est qu'ils craignent qu'on ne les oblige à travailler. Froger, Relations du voyage de Gennes.
(45) La couleuvre jaune bleue de Java se cache quelquefois dans les champs de riz, et plus volontiers dans les bois touffus. Sa longueur ordinaire est de neuf à dix pieds : mais on en voit de si grandes, qu'on les a comparées à de gros arbres. Cette couleuvre, que sa force rend redoutable, se nourrit d'oiseaux, et même d'animaux assez gros. Consultez les Mémoires de la société de Batavia, année 1787.
(46) On connaît l'horreur que les singes ont pour les serpents ; la vue seule de la peau d'un de ces reptiles suffit pour les faire tomber en défaillance. Le voyageur Levaillant avait tué à la chasse un gros serpent. « Je remarquai dans cette occasion, dit-il, toute la frayeur que ces animaux inspirent aux singes. Il n'était pas possible de faire approcher Kees du serpent dont je venais de m'emparer, quoiqu'il fût entièrement expiré. » Voyage en Afrique, tome II, p. 258. — Cette crainte est bien naturelle ; car les singes, qui, par leur légèreté et leur habitude de dormir sur les arbres, échappent aux lions, aux tigres, aux autres bêtes féroces, et même à l'homme, n'ont point d'ennemis plus redoutables que ces affreux reptiles, qui grimpent en rampant et vont les surprendre jusque sur les branches les plus élevées.
(47) Si l'on en croit M. Desfontaines (note communiquée à M. de Buffon), le teint de diverses espèces de singes est sujet à s'altérer lorsqu'ils sont saisis d'effroi. Hist. nat., addit. à l'art. Pithèque.
Acorn
N.B. — Nous n'avons ni le moyen ni l'envie de mettre ces notes au courant de l'état actuel des sciences naturelles. Notons seulement que si l'orang-outang était déjà assez bien connu au commencement de ce siècle, le gorille l'était très mal. Sur cet grande espèce, consultez les diverses relations de M. Paul du Chaillu, notamment l'Afrique sauvage, 1867, in-8º, et Histoire du pays des gorillas, 1868, in-8º.
Jocko, par M. C. de Pougens. Précédé d'une notice par Anatole France. Paris: Charavay Frères, 1881. Jocko et Preuves: pp. 4-129.
This page is by James Eason.